Chaque année, le 17 avril, a lieu la Journée mondiale de l’hémophilie, une date clé pour sensibiliser à cette maladie rare et hémorragique qui touche des milliers de personnes à travers le monde. L’occasion de s’informer, de mieux comprendre les défis rencontrés par les patients au quotidien, et de souligner les avancées médicales et humaines dans leur prise en charge.
Dans cet article, nous vous proposons un dossier complet sur l’hémophilie : de ses causes à son traitement, en passant par ses symptômes et son impact sur la vie des personnes concernées.
Qu’est-ce que l’hémophilie ?
L’hémophilie est une maladie génétique héréditaire qui affecte la capacité du sang à coaguler. Plus précisément, elle résulte d’un déficit en protéines appelées facteurs de coagulation, indispensables à l’arrêt des saignements. Il existe deux formes principales :
- L’hémophilie A, causée par une absence ou une baisse du facteur VIII
- L’hémophilie B, liée à une anomalie du facteur IX
Ces facteurs sont essentiels pour former un caillot sanguin et stopper les saignements. Sans eux, même une petite coupure ou une ecchymose peut entraîner un saignement prolongé, voire une hémorragie interne.
Une maladie majoritairement masculine
L’hémophilie est une maladie liée au chromosome X, ce qui signifie qu’elle touche surtout les garçons. Les filles, ayant deux chromosomes X, peuvent être porteuses saines ou, dans de rares cas, présenter des symptômes légers si les deux chromosomes sont affectés ou si l’un est inactif.
On estime qu’environ 1 garçon sur 10 000 naissances est concerné par l’hémophilie A, tandis que l’hémophilie B est encore plus rare, avec 1 cas sur 30 000. En Belgique, cela représente plusieurs centaines de patients suivis dans des centres spécialisés.
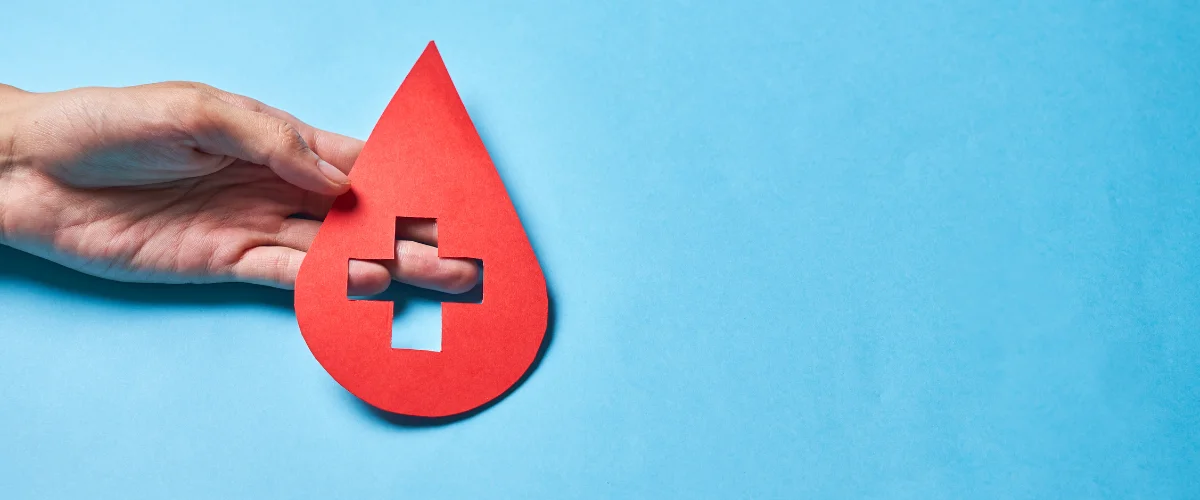
Les signes cliniques de l’hémophilie
Les premiers symptômes apparaissent généralement dès la petite enfance. Parmi les signes les plus courants :
- Saignements prolongés après une coupure ou une opération (ex. : circoncision, extraction dentaire)
- Hématomes fréquents, même après de légers chocs
- Saignements articulaires (hémarthroses), notamment au niveau des genoux, des coudes ou des chevilles
- Saignements musculaires ou internes pouvant être douloureux et invisibles
- Sang dans les urines ou les selles, dans les cas plus graves
Les hémarthroses répétées peuvent provoquer une dégradation articulaire progressive (arthropathie hémophilique), limitant la mobilité et entraînant des douleurs chroniques.
Diagnostic de l’hémophilie : un enjeu de précocité
Le diagnostic de l’hémophilie repose sur une analyse du sang permettant de mesurer l’activité des facteurs de coagulation. Il est souvent posé :
- À la naissance si un membre de la famille est porteur
- Lors des premiers épisodes hémorragiques inexpliqués
- À l’occasion d’un acte médical entraînant un saignement excessif
Un diagnostic précoce est essentiel pour mettre en place une prise en charge adaptée et prévenir les complications. En cas de suspicion, le patient est généralement orienté vers un centre de traitement de l’hémophilie pour un suivi spécialisé.
Traitement et prise en charge de l’hémophilie
Le traitement repose sur l’administration du facteur de coagulation manquant, par injection intraveineuse. Il existe deux approches principales :
- Le traitement à la demande : administré en cas de saignement
- Le traitement prophylactique : injections régulières visant à prévenir les saignements
Le traitement peut être réalisé à domicile, notamment chez les enfants ou les patients autonomes, grâce à un apprentissage de l’auto-injection. Ce suivi est souvent complété par des consultations régulières avec des hématologues, kinésithérapeutes, orthopédistes et psychologues.
Depuis quelques années, de nouveaux traitements innovants ont vu le jour, comme les anticorps monoclonaux (ex. : émicizumab) ou encore la thérapie génique, encore en phase d’étude mais porteuse d’espoir pour une guérison à long terme.
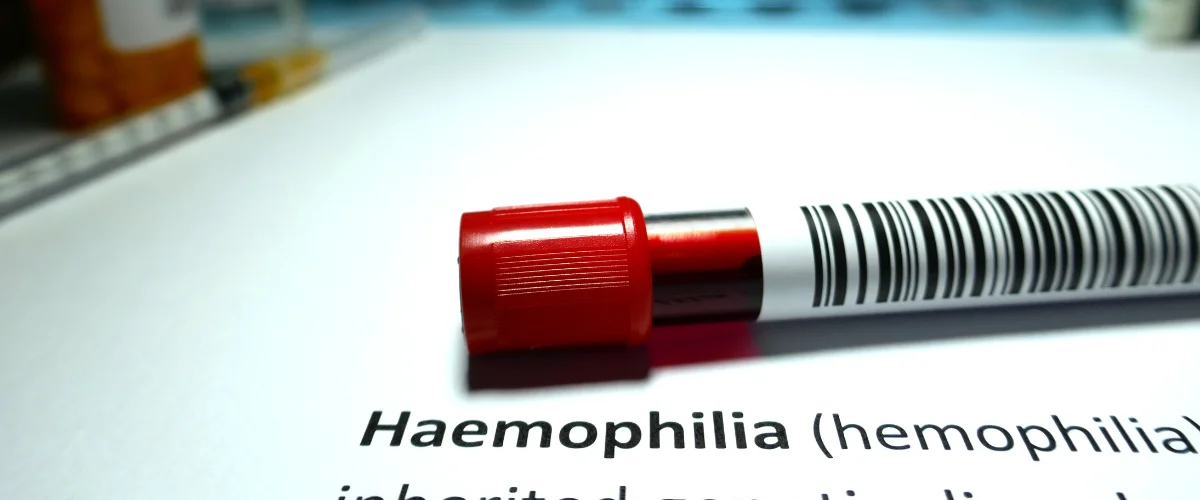
L’impact de l’hémophilie au quotidien
Vivre avec l’hémophilie implique une vigilance constante et une organisation rigoureuse des soins. Les patients doivent éviter certaines activités à risque (sports de contact, chutes), surveiller les signes de saignements internes, gérer leurs traitements, et parfois composer avec des douleurs articulaires chroniques.
L’enjeu principal est d’éviter les complications graves tout en permettant aux patients, enfants comme adultes, de mener une vie la plus normale possible. Cela passe par :
- Une bonne éducation thérapeutique
- Un suivi médical régulier
- Un environnement familial et scolaire sensibilisé
- Des aménagements professionnels si nécessaire
La scolarité, la parentalité, la sexualité ou encore les voyages sont autant de domaines qui peuvent nécessiter un accompagnement spécifique pour les personnes hémophiles.
L’importance de la sensibilisation et de l’accompagnement
L’hémophilie, comme d’autres maladies chroniques rares, reste encore méconnue du grand public. La Journée mondiale de l’hémophilie, organisée chaque 17 avril par la Fédération mondiale de l’hémophilie, vise à :
- Informer sur les causes, symptômes et traitements de la maladie
- Donner la parole aux patients et à leurs familles
- Mettre en lumière les inégalités d’accès aux soins dans le monde
- Soutenir la recherche médicale
Au-delà du soin médical, les patients ont souvent besoin d’un accompagnement humain, d’un suivi personnalisé et d’une écoute attentive de la part de tous les professionnels de santé.

Chiffres-clés sur l’hémophilie
- 400 000 personnes vivent avec l’hémophilie dans le monde
- 75 % d’entre elles n’ont pas accès à un traitement adapté
- En Belgique, environ 1 personne sur 10 000 est concernée
- L’espérance de vie des patients traités est aujourd’hui quasi normale
Conclusion : une maladie rare, mais pas invisible
L’hémophilie est une maladie complexe, mais des avancées notables ont permis une nette amélioration de la qualité de vie des patients. Informer, sensibiliser, et accompagner sont les maîtres-mots en ce 17 avril, Journée mondiale de l’hémophilie.
Professionnels de santé, proches, éducateurs ou simples citoyens : chacun peut jouer un rôle dans la lutte contre la stigmatisation, l’amélioration de la prise en charge, et le soutien des personnes vivant avec l’hémophilie.
